|
CultureMATH - accueil - contact Avant et après Boole, l'émergence de la logique moderne |
1- Avant Boole : un lent cheminement
Article
déposé le 28/01/2011. Editeur: Eric
Vandendriessche. Toute reproduction
pour publication ou à des fins commerciales, de la
totalité ou d'une partie de
l'article, devra impérativement faire l'objet d'un accord
préalable avec l'éditeur (ENS Ulm). Toute
reproduction à des fins privées, ou
strictement pédagogiques dans le cadre limité
d'une
formation, de la totalité ou d'une partie de l'article, est
autorisée sous
réserve de la mention explicite des
références éditoriales
de l'article.
Version [pdf] (680 ko, 22p.)
|
SOMMAIRE 1.Les
Origines : l'Art de penser
2. Une nouvelle orientation 3.Toujours pas de résultat 4.Exécution de la syllogistique 5.Pour conclure Encart 1: La logique scolastique Encart 2: Les cercles d'Euler Bibliographie |
1- Les Origines : l'Art de penser
Nous ne parlerons pas de la logique antique ni de celle du Moyen Âge, sujets vastes et complexes, dont les rapports à ce qui nous intéresse pour être réels, n’en sont pas moins non pertinents (un exposé succinct de la scolastique classique se trouve dans l'Encart 1). La première tentative de fonder une logique sur des bases « modernes », c’est à dire rationnelles, date de 1662. C’est, publiée en français, La Logique ou l’Art de Penser d’Antoine Arnauld (1612-1694) et Pierre Nicole (1625-1695), plus connue sous le nom de Logique de Port-Royal.
Figure 1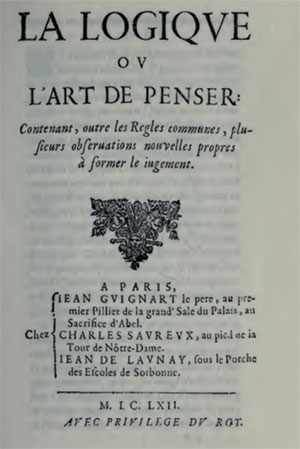 La première édition de la Logique de Port-Royal |
Le sous-titre doit être souligné car il
nous indique le statut donné alors à la logique,
et la place que ses auteurs lui assignent parmi les connaissances. Mais
un autre aspect de cet ouvrage mérite une attention
particulière, c’est sa liaison, même
indirecte avec les mathématiques de son temps. En effet, un
des enjeux pour les auteurs était de prendre en compte la
percée scientifique et philosophique réussie par
René Descartes (1596-1650) et de donner une logique
correspondant à l’état des
connaissances de la seconde moitié du XVII°
siècle, complètement bouleversées par
les retombées du Discours de la Méthode
de 1637.
Il semble clair que la logique scolastique, toute
façonnée à l’image des
universités médiévales où
les raffinements rhétoriques liés à la
pratique généralisée de la
«
Disputatio » étaient poussés
à leur point culminant, se trouvait totalement en
porte-à-faux dans une société
où les nécessités historiques de mise
en place et de développement d’une vision
scientifique efficace se faisaient sentir. Le formalisme
caractérisant la syllogistique classique avec ses nombreuses
règles complexes est rejeté car non seulement il
est stérile, mais il peut engendrer des erreurs faute de
compréhension :
«. . . il arrive que
s’attachant plus à l’écorce
des règles qu’au bon sens qui en est
l’âme, ils se portent facilement à
rejeter comme mauvais des raisonnements qui sont très bons .
. .nous devons plutôt examiner la solidité
d’un raisonnement par la lumière naturelle que par
les formes. » [Arnauld&Nicole,
1662, p. 280]
On se rappelle le peu de
considération dont Descartes a toujours fait preuve vis
à vis de la logique qu’on lui avait
enseignée, d’abord dans les Regulae ad
directionem
ingenii écrites en 1628, où il justifie
son
omission des principes des Dialecticiens [règle
X] :
« C’est qu’en effet
nous remarquons que
la vérité s’échappe souvent
de ces liens, alors que cependant ceux-là même qui
s’en servent y demeurent enlacés. ».[Descartes,
1628,
réédition 1970, p. 280]
Son
opinion n’est pas modifiée dans le Discours
de la
méthode de 1637 où il
déclare dans la
seconde partie :
« . . . pour la logique, ses syllogismes et la
plupart de ses autres instructions servent plutôt
à expliquer à autrui les choses qu’on
sait ou même, comme l’art de Lulle, à
parler, sans jugement de celles qu’on ignore,
qu’à les apprendre. Et bien qu’elle
contienne en effet beaucoup de préceptes très
vrais et très bons, il y en a toutefois tant
d’autres, mêlés parmi, qui sont ou
nuisibles ou superflus, qu’il est presque aussi
malaisé de les en séparer que de tirer une Diane
ou une Minerve hors d’un bloc de marbre qui n’est
point encore ébauché. »[Descartes,
1637, réédition 1966, p. 46]
Pour dépasser ce formalisme, rompant avec les
traités de logique antérieurs, des
nouveautés seront donc introduites dont les sources sont
avouées dès le discours
préliminaire :
« On est obligé
néanmoins de
reconnaître que ces réflexions qu’on
appelle nouvelles, parce qu’on ne les voit pas dans les
logiques communes, ne sont pas toutes de celui qui a
travaillé à cet ouvrage, et qu’il en a
emprunté quelques unes des livres d’un
célèbre philosophe de ce siècle, qui a
autant de netteté d’esprit qu’on trouve
de confusion dans les autres. On a aussi tiré quelques
autres d’un petit Ecrit non imprimé, qui avait
été fait par un excellent esprit qu’il
avait intitulé De l’Esprit
Géométrique,. . . . ». [Arnauld&Nicole,
1662, réédition 1970, p.
15-16]
Bien que restant volontairement implicite, la double
référence à Descartes et Pascal
n’en est pas moins transparente.
La logique est conçue comme :
« l’art de bien conduire sa
raison dans la
connaissance des choses tant pour s’instruire
soi-même que pour instruire les autres. Cet art consiste dans
les réflexions que les hommes ont faites sur les quatre
principales opérations de leur esprit, concevoir,
juger, raisonner et ordonner. »
[Arnauld&Nicole,1662, réédition
1970 p. 23]
Son but est pratique et d’un usage commun dans tous
les domaines de la vie
« Ainsi la principale application
qu’on
devrait
avoir, serait de former son jugement et de le rendre aussi exact
qu’il peut être, et c’est à
quoi devrait tendre la plus grande partie de nos études. On
se sert de la raison comme d’un instrument pour
acquérir les sciences; et l’on se devrait servir
au contraire des sciences comme d’un instrument pour
perfectionner sa raison. ».
[Arnauld&Nicole, 1662, réédition
1970, p. 6]
Figure 2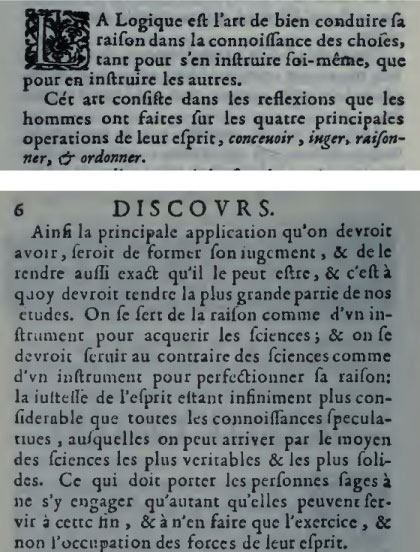 La logique et sa fonction selon les messieurs de Port-Royal [Arnauld & Nicole, 1662] |
Pour atteindre le but qui lui est assigné, la logique est transformée principalement par l’incorporation d’une sorte de sémiotique, une tentative de théorie du langage. Son fonctionnement vient renforcer les efforts du même Arnauld d'une étude globale du langage et du raisonnement sur des bases rationnelles, commencé avec la Grammaire générale et raisonnée de 1660, et qui sera appliquée dans sa Géométrie de 1667. De nombreux exemples non classiques sont empruntés à la théologie ou à la géométrie, voire à la vie civile et sont justifiés par la critique qu’à force d’abstraction « ils [les exemples] s’accoutument à renfermer la Logique dans la logique, sans l’étendre plus loin, au lieu qu’elle n’est faite que pour servir d’instrument aux autres sciences. »[Arnauld&Nicole, réédition 1664, Second Discours p. xxxvi]. Les résultats établis antérieurement concernant la syllogistique ne sont bien entendu pas modifiés et donc repris pour ce qu’ils sont, avec un allègement des règles, mais les nouvelles considérations introduites concernant l’art de penser vont élargir la base de réflexion et ouvrir la voie à de nouveaux problèmes. Les trois premières parties de l’ouvrage concernent « la première action de l’esprit qui s’appelle concevoir » puis « les réflexions que les hommes ont faites sur leurs jugements » et ensuite « du raisonnement » donnent une orientation moderne à l’ensemble qui ne se limite donc pas à la syllogistique ; mais surtout l’ouvrage se conclut sur une quatrième partie étendue qui reprend une innovation de Pierre La Ramée, (Petrus Ramus 1515-1572) en 1555, De la méthode, qui montre que son ambition dépasse les traités existant alors.
Mais il y avait d’autres enjeux, liés
ceux-là à l’agitation
théologique qui a suivi la mise en place par
l’église catholique de la «
Contre-Réforme ». Les « Messieurs de
Port-Royal » avaient besoin de montrer que leur vision
n’était pas seulement vraie, mais
qu’elle seule était soutenable en raison, en
quelque sorte scientifique (il n’est
qu’à considérer la tentative
pascalienne de démonstration de l'existence de Dieu
débouchant sur l’échec du pari.) Une
manière d’en faire la preuve était de
produire une logique d’où les positions
jansénistes sembleraient sortir comme une
nécessité. La recherche de la
Vérité dans une religion fondée sur la
Parole exige l'étude rationnelle des faits de langage.
Logique et grammaire concourent ainsi conjointement à la
détermination d'une pensée vraie. On assiste
alors à une sorte d’élargissement du
rôle de la logique qui intervient dans toutes sortes de
questions. Ainsi, la cinquième édition, en 1683,
contient des modifications et de nombreux ajouts dont le but est ainsi
précisé :
« On verra par ces
éclaircissements que la raison
et la foi s’accordent parfaitement, comme étant
des ruisseaux de la même source et que l’on ne
saurait guère s’éloigner de
l’un sans s’écarter de
l’autre. Mais quoique ce soient des conditions
Théologique qui ont donné lieu à ces
additions, elles ne sont pas moins propres ni moins naturelles
à la Logique; et l’on aurait pu les faire quand il
n’y aurait jamais eu de Ministres au monde qui auraient voulu
obscurcir les vérités de la foi par de fausses
subtilités. »
[Arnauld&Nicole, réédition 1683,
p. vii]
La logique d’Aristote sera aussi étendue aux
apports de Gallien et des Stoïciens pour embrasser une plus
grande variété de méthodes de preuves,
montrant ainsi la volonté de produire un outil efficace pour
raisonner dans les cas les plus divers.
La Logique de Port Royal marque ainsi un tournant dans la mesure où elle rompt radicalement avec ce qui l’a précédé tant dans ses intentions clairement énoncées et mises en pratique de fournir des arguments, que dans son ancrage revendiqué dans les développement des connaissances les plus récentes. Cet ouvrage a joué un grand rôle par sa diffusion puisqu’il a connu 44 éditions françaises, ainsi que des éditions anglaises et latines. Il a été durant presque deux cent ans une référence en matière de logique. Celle-ci ne semble plus dès lors confinée à un monde limité de spécialistes, mais à travers son exposition accessible à l' « honnête homme » et ses possibilités d’application à la vie civile, peut participer à la culture commune.
2- Une nouvelle orientation
Il est alors temps de parler d’un acteur de cette histoire qui a beaucoup fait, dans tous les sens, mais pratiquement en secret puisque ses travaux principaux en logique n’ont été révélés qu’au début du XX° siècle. En effet, seule la partie connue de la correspondance de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) a pu dévoiler à ses contemporains ses idées sur le développement du sujet, et pourtant elles étaient nombreuses. Mais dans la mesure où elles n’ont été que peu connues, leur influence fut de peu d’importance, sauf pour les quelques logiciens qui ont exploité cette correspondance. Ce qui était par contre sur la place publique, mais uniquement à partir de 1765, se trouvait dans les Nouveaux essais sur l’entendement humain (écrits en français) qui traduisaient la réaction de l’auteur à la philosophie exprimée par John Locke (1632-1704), fondateur de l'empirisme, dans son Essay concerning human understanding de 1690. Commencés dès 1690, ces discussions philosophiques entre Théophile-Leibniz et Philalète-Locke, portant essentiellement sur la nature des idées simples – Locke argumentant qu’elles sont le fruit des perceptions, et Leibniz qu’elles sont innées – ne furent achevées qu’après la mort de Locke et Leibniz ne les publia pas de son vivant. On n’y trouvera pas de développement technique (dont ce n’est pas le lieu), mais un exposé des conceptions de base dans un cadre philosophique. Pour ce qui concerne la logique, c’est principalement le livre quatre qui nous intéresse.
La pensée de Leibniz repose entièrement
sur la conviction que toute vérité est
analytique. Dès lors, la décomposition la plus
minutieuse des concepts peut mener aux vérités
ultimes dont toutes les autres sont composées et ceci est
d’application universelle. Comme nous nous exprimons et
pensons en mots, la confection d’une langue à
partir des véritables définitions des concepts
permettrait d’aboutir à une «
Caracteristica Universalis » dans laquelle toute
vérité serait obtenue par combinaison,
c’est à dire par synthèse, des
vérités premières, en court-circuitant
la langue naturelle et ses ambigüités. Leibniz
rejoint par là une idée répandue
à son époque, (peut-être
après avoir pris conscience de la grandeur et de la
diversité du monde qui ne se confinait plus à la
Méditerranée ?) de tentative de langue
universelle, et pour lui la syllogistique peut en être vue
comme un brouillon qu’il s’agit de
développer :
« Je tiens que l’invention de la
forme des
syllogismes est une des plus belles de l’esprit humain et
même des plus considérables. C’est une
espèce de mathématique universelle dont
l’importance n’est pas assez connue; et
l’on peut dire qu’un art
d’infaillibilité y est contenu, pourvu
qu’on sache et qu’on puisse s’en bien
servir, ce qui n’est pas toujours permis. »
[Leibniz, 1765, livre IV, chap. xvii, parag. 4]
Sa philosophie s’exprime aussi en logique où son
credo maintes fois réitéré est
« praedicatum inest subjecto »
(le
prédicat est contenu dans le sujet) dont il ne se
départira jamais : puisque toute
vérité est analytique, un sujet n’est
parfaitement défini que si on peut mettre en
évidence une décomposition complète de
ses propriétés. Sa vision est donc
essentiellement une logique intensive, en compréhension,
comme il le précise lui-même :
« Car disant tout homme est animal, je veux
dire que tous les
hommes sont compris dans tous les animaux ; mais j’entends en
même temps que l’idée de
l’animal est comprise dans l’idée de
l’homme. L’animal comprend plus
d’individus que l’homme, mais l’homme
comprend plus d’idées ou plus de
formalités ; l’un a plus d’exemples,
l’autre plus de degrés de
réalité ; l’un a plus
d’extension, l’autre plus d’intention.
»
[Leibniz, 1765, livre IV, chap. xvii, parag. 8]
Il n’est pas inutile de prendre ici le temps de clarifier un peu ce point qui, nous le verrons plus tard, n’est pas sans importance.
Pour nous « Tout homme est mortel » est immédiatement compris, relativement à l’extension des classes correspondantes, comme : 'chaque élément de la classe des hommes est dans la classe des mortels', car nous sommes habitués à cette vision dite extensive.Mais pendant presque deux millénaires cette affirmation était traduite, en référence au langage, intentionnellement : être mortel est une des propriétés qui définit un homme ; autrement dit un homme est un mortel qui possède en plus d’autres propriétés, et ainsi il a plus dans homme que dans mortel.
Ce qui importe dans notre point de vue extensif est la possibilité de considérer comme une totalité en soi l’étendue de tous les objets correspondant à un critère fixé. Or ceci n’a rien d’évident, et sa banalité pour nous est, en fait, totalement culturelle car c’est à cette vision des choses que nous avons été entrainés lors de nos études. Mais si l’on regarde de plus près, on s’aperçoit que depuis Aristote ce qui était considéré comme objet en logique était bien plutôt l’ensemble des qualités qui définissaient le nom collectif, d’un point de vue intensif. Alors que nous considérons que le sujet est compris dans le prédicat, c’est le contraire qui a été la règle pendant plusieurs siècles.
Après ces précisions indispensables pour la compréhension de l'exposé, nous pouvons revenir à Leibniz.
Les progrès de l’algèbre lui laissent espérer la mise au point d’une écriture rationnelle « ars characteristica sive lingua rationnalis » qui par sa généralité dépasserait les nombres et les quantités. Si l’on dispose des bonnes définitions et des opérations qui peuvent les combiner, il n’y a plus qu’à calculer, pour établir toutes les vérités, d’où son « Calculemus » qui mettrait fin à toutes les controverses. C’est pourquoi Leibniz tentera à de nombreuses reprises de partir des syllogismes pour mettre sur pied un tel système. Sans détailler ces tentatives multiples qui partent dans tous les sens, parfois se recoupent, parfois non, où les notations fluctuent et où il arrive de ne pas savoir de quoi il s’agit, car ce sont des brouillons, il est cependant quelques traits saillants. Leibniz utilise des variables, notées par des lettres majuscules ou minuscules, qui désignent les termes sur lesquels il emploie des opérations unaires et binaires, ainsi que des relations binaires. En utilisant des règles (qui restent presque toujours implicites) il tente, avec ces éléments, de développer un système qui étende la syllogistique, mais il n’aboutit jamais, et donc ne publie pas. Ce qui traverse tout ce travail, c’est l’intervention constante d’une écriture de type mathématique, sans que jamais l’auteur n’attire l’attention sur cet aspect dans la mesure où elle lui semble aller de soi.
C’est Louis Couturat (1868-1914) dans ses études : La logique de Leibniz (1901), et Fragments et Opuscules (1903), qui a popularisé une partie de ces études logiques. Il y distingue trois groupes de travaux (outre des fragments épars) qui sont si disparates que toute synthèse est impossible. Pourtant on y trouve des idées qui pour certaines d’entre elles sont réapparues ailleurs plus tard.
Figure 3 : Deux
exemples de recherches de Leibniz [Couturat, 1903, p. 295 et 235]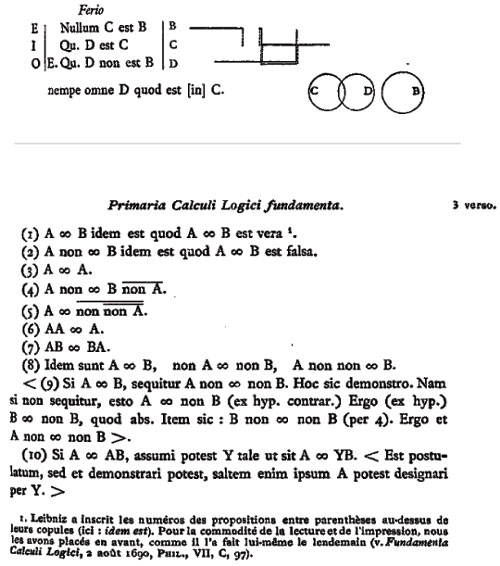 |
Par exemple dans la notation des concepts simples par des nombres premiers (ce dont Kurt Gödel (1906-1978) se souviendra efficacement lors de la démonstration de son célèbre théorème d’incomplétude en 1931) : si « animal » est noté 2 et « être raisonnable » est noté 3, « homme » (qui est un animal raisonnable) sera noté 6, la conjonction des propriétés correspondant ici au produit numérique. Pour donner une idée d'ensemble de ces écrits, on peut mentionner en vrac d’autres nouveautés qui se retrouveront éventuellement. La négation d’un terme quelconque, avec les règles a = non-non-a et l’équivalence entre « a est b » et « non-b est non-a ». L’apparition d’une constante d’existence « Ens » : « quidam homo est doctus » devenant « homo doctus est Ens » et pour la négation « nullus homo est lapis » donnant « homo lapis est non Ens ». La distinction entre égalité et inclusion avec une notation intéressante : « A est B idem est quod A continet B et quidem simpliciter, ut adeo dicere liceat A est B idem esse quod A ∞ B »; (∞ note ici le signe d’égalité) et ailleurs pour la même situation concernant A et B « A coincidere ipsi BY (. . . ) Nota enim Y significa aliquid incertum. . . . ». On trouve aussi « Coincidunt A et AA et AAA . . . ». Dans un autre fragment, la mise en parallèle des noms et des adjectifs permet un passage entre l’intensif et l’extensif : une propriété, « animal » correspondant à une classe « ens animal ».
L’introduction d’un zéro logique par l'écriture : 0 = C non-C lui permet de montrer : (AB = 0) = (A = Anon-B). Ce qui en rhétorique s'énoncerait : « les propositions 'A et B sont contradictoires' et 'A est formé de non-B' sont équivalentes » peut ainsi s'exprimer sous une forme calculatoire où coexistent deux signes d'égalité sémantiquement différents.
Il conçoit une soustraction comme différence de deux concepts, et tente de l’utiliser ainsi. La traduction de « A est B » sous la forme « B = A + B », lui donne l’égalité logique « A + A = A » qu’il distingue de l’égalité algébrique « A + A = 2A ». On trouve aussi un traitement équivalent des propositions hypothétiques[1] et catégoriques[2], (et nous verrons que Boole retrouvera ceci) et un fragment dont l'objet, non précisé, peut être aussi bien le calcul des termes que le calcul propositionnel. Il existe aussi un essai où le point de vue est extentionnel et doté de représentation de cette extension sous forme de segments, mais après cette exposition, Leibniz passe à la compréhension pour faire des calculs sur la base de la traduction de « omne C est B » en « C = BC. » Il semble que dans ses derniers écrits logiques, Leibniz ait orienté ses réflexions sur la contenance (continente et contento), entendue au sens large (qu’il différencie de la relation entre le tout et les parties, qui est toujours stricte) qui lui semblait plus sûre pour traduire les relations.
On voit la variété et la richesse des tentatives existantes, même si elles n’aboutissent pas. On peut cependant dire à sa décharge qu'il fut bibliothécaire à plein temps à Hanovre durant quarante ans, se lança dans l'écriture de l'histoire des ducs de Brunswick, co-inventa le calcul différentiel, fit un peu de physique et rédigea de la philosophie, de sorte que les moments qu'il pouvait consacrer à la logique ont dû être rares.
S’il ne peut prendre de la distance par rapport aux calculs algébriques auxquels il reste attaché, Leibniz n’arrive jamais non plus à abandonner les syllogismes traditionnels et si une idée se présente qui pourrait l’en distraire en cours de route, il préfère abandonner l’idée pour revenir au classique ; mais ce qui est flagrant, c’est qu’un premier rapprochement a été fait entre la logique et les mathématiques, ne serait-ce que concernant l’écriture.
3 – Toujours pas de résultat
Cet élan ainsi donné, où les mathématiques interféraient avec la logique, allait s’amplifier puisque de nombreux mathématiciens allaient traiter de la logique. Un des plus intéressants à suivre cette voie fut Johan Heinrich Lambert (1728-1777), qui est resté célèbre pour avoir prouvé l’irrationalité de π, et par ses tentatives, bien sûr vaines, de démontrer le cinquième postulat d’Euclide, ouvrant ainsi la voie aux géométries non-euclidiennes. Son œuvre majeure en logique est Neues Organon publiée en 1764, soit un an avant les Nouveaux Essais de Leibniz, où il tente de se poser en nouvel Aristote en fondant une « Vernunflehre », science générale des enchainements de concepts, allant bien au-delà de la syllogistique. Les quatre parties se nomment Dianoiologie, Aléthiologie, Sémiotique et Phénoménologie. La première correspond à la logique classique que Lambert tente de réduire à une suite de calculs portant sur des signes de concepts, le traitement étant donc fondamentalement intentionnel et on y trouve une représentation linéaire des syllogismes classiques sous forme de segments dans la manière de Leibniz. Il tente de ramener à la forme syllogistique les propositions catégoriques et conditionnelles et en donne sept formes qu’il baptise par imitation de la dénomination mnémotechnique de la syllogistique. Dans la dernière partie, Lambert aborde les probabilités et montre alors que certains syllogismes où les prémisses sont particulières peuvent conclure, pour peu que l’indétermination ne soit pas totale.
Une partie de ses idées est exposée dans Sechs Versuche einer Zeicheinkunst écrit avant l’Organon mais publié en 1782, (donc posthume), par J. Bernoulli, dans Logische und Philosophische Abhandlungen.
| Figure
4 Table des matières de la première partie de Neues Organon [Lambert, 1764] 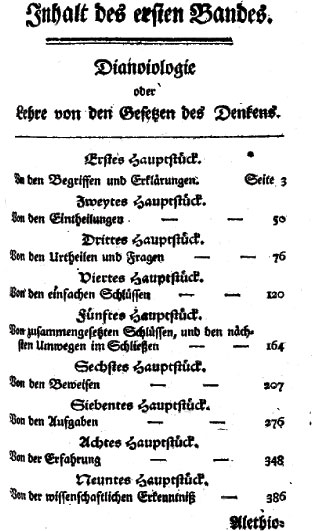 |
Il se livre à
plusieurs sortes de calculs, sur les
mêmes bases que dans l’Organon.
Reprenant la
définition aristotélicienne d’un
concept en genre et en différence, dont les symboles
fonctionnent comme opérateurs, il aboutit à une
sorte de « formule de Newton »[3]
dont il ne
fait rien. Les rapports entre concepts, simples ou complexes, donnent
aussi lieu à des développements qui peuvent
être compliqués, dans la mesure où les
ambiguïtés sur la nature des objets supportant les
calculs sont réelles, mais jamais il n’y a
résolution de problème. Cependant, on peut
trouver une sorte de quantification spontanée du
prédicat qui donne lieu encore une fois à des
calculs. Les deux propositions affirmatives ‘Tout A est
B’ et ‘Quelques A sont B’ sont traduites
par :
A = B en cas d’identité
A > B si A n’est pas tout B
A < B si quelques A forment tout B
mA > B et A < nB si A et B ont une partie commune. [ La
notation mA désigne ici une partie de A et nB une partie de
B.]
Figure
5 : Exemple de calculs dans [Lambert, 1782, p. 97]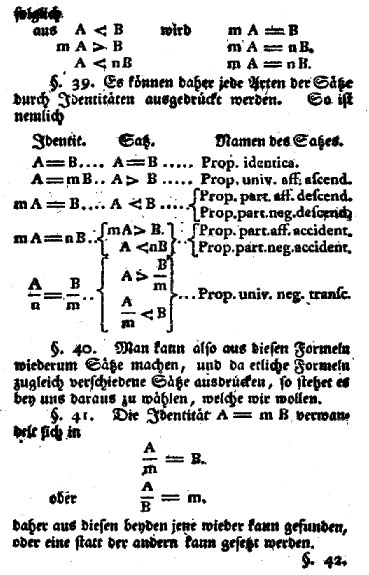 |
Et d’une manière systématique Lambert remplace les inégalités par des égalités : « A < B » devient « mA = B » ou même « A = B/m », la division, surprenante mais introduite sans explication, au fil du calcul, fonctionnant implicitement, dans certains cas, sans problème apparent. Il obtient ainsi cinq formes, qui en fait ne sont que quatre, les deux dernières étant identiques. A partir de là, il y a reconstitution de toute la syllogistique sous la forme de calculs et la mise en évidence de la forme générale du syllogisme. Il pense alors avoir produit de nouveaux syllogismes, mais ils sont illusoires car dans sa notation, « mA = nB » désigne à la fois une affirmative et une négative. Concernant les relations entre concepts, il tente encore une fois des calculs à partir d’une base algébrique, ce qui donne des choses curieuses. Un traitement algébrique formel systématiquement appliqué à des objets dont la nature n’est pas stable, à travers des formes relationnelles qui ne sont pas toujours bien fondées, ne permet pas d’aboutir à un résultat probant.
Il se dégage de ces travaux l’impression d’une volonté farouche de calculer, avec les moyens du bord, à peu près sur tout ce qui se présente, ce qui conduit à mettre en évidence des formes qui trouvent des échos dans la mathématique de l’époque, (par exemple la formule de Taylor[4]. Mais ce symbolisme quasiment rageur fonctionne en vase clos puisque jamais il n’est utilisé pour résoudre aucun problème, mais aurait-il pu l’être ? De plus, l’horizon et le cadre restent ceux d’Aristote, puisqu’on ne voit pas de raison pour envisager autre chose. Cependant, en cette fin du XVIII°, il est alors clair, car Lambert n’est pas le seul à se livrer à ce type de travaux, qu’une nouvelle voie s’est ouverte à la suite de Leibniz et que les philosophes ne sont plus les seuls à se sentir concernés par les questions posées par la logique.
4 – Exécution de la syllogistique
Au début du
XIX° siècle, une
tentative isolée et originale mérite
d’être signalée, à un endroit
où l'on ne l'attendrait pas. En effet, Joseph-Diez Gergonne
(1771-1859), reprenant le vocabulaire d’Aristote, donne
à lire dans le tome 7 de ses célèbres
« Annales de mathématiques pures
et
appliquées »
l’article « Essai
de dialectique rationnelle » en 1817, qui
est une exposition
originale (basée sur la combinatoire) de la syllogistique
(dont il n’a pas une haute opinion). Son point de
départ est fondé sur la situation de deux
idées relativement à leur étendue, ce
qui donne cinq situations qu’on peut figurer par des cercles
dits d’Euler (Voir Encart 2)
et
qu’il note par les signes
I, H, X, C et Ͻ. Ceci ne rend pas compte des quatre situations
classiques qu’il note A, N, a et n, mais il donne deux
tableaux permettant de les faire correspondre. Il montre ensuite les
possibilités de conversion et retrouve sans fatigue les
règles classiques. Il s’attaque ensuite aux
syllogismes dont le nombre total est, a priori, 256 (64×4).
C’est alors, par un examen combinatoire de ces situations,
qu’il peut exclure les cas non concluant et trouve
vingt-quatre formes
concluantes. Il fait justement la remarque:
« Les traités de
dialectique, même
les plus complets, ont à peu près tous
négligé de prouver, à la fois,
nettement 1° que ces vingt quatre formes sont toutes
concluantes, 2° qu’elles sont les seules qui puissent
l’être. C’est pourtant en ceci le point
capital. » [Gergonne, 1817, p.
223]
| Figure 6 Les tableaux de correspondance [Gergonne, 1817, p. 198 et 204] 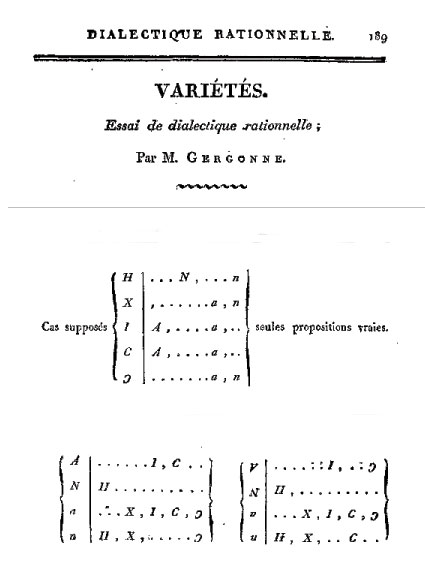 |
Il lui est alors aisé d’énoncer les règles générales gouvernant les syllogismes puis de procéder à la réduction de ceux-ci, retrouvant les dix neufs formes classiques. Ce qui frappe dans cet exposé est le caractère totalement abstrait du traitement; où l’on ne trouve aucun exemple, mais uniquement des considérations combinatoires sur des signes qui dénotent soit des situations de classes soit des propositions, pour mettre en évidence les incompatibilités. Ainsi il n’a pas fallu plus d’une quarantaine de pages de raisonnements combinatoires simples, quasiment au fil de la plume, avec, comme il le souligne lui-même, « Clarté, rigueur et brièveté » pour que Gergonne mette fin à la syllogistique qualifiée par lui de « gothique » qu’il tenait en piètre estime : « une science toute de mots dans laquelle on a cherché à masquer, sous la sévérité des formes, le vide absolu du fond. » [Gergonne, 1817, p. 189]
Et pourtant pendant des années encore, on trouvera
des
exposés sur la syllogistique, mais on peut penser que seuls
des mathématiciens semblent avoir lu Gergonne. La
justification est peut-être donnée par
l’auteur lui-même :
« . . .
la doctrine que j’expose, et plus encore la forme sous
laquelle je la présente, ne saurait guère
être bien saisie que par les géomètres,
ou du moins par ceux qui possèdent l’esprit
géométrique. ».
[Gergonne, 1817, p.
191]
Pour conclure ce chapitre
On voit qu'au début du dix-neuvième siècle, il n'existe rien d'abouti qui ressemble à la logique qui est la nôtre, mais que des tentatives ont été faites d'utiliser les techniques de calcul mathématique pour tenter d'améliorer la logique. Les conditions permettant l'évolution positive que nous connaissons sont en train de se mettre en place.
Bibliographie
Arnauld, Antoine et Nicole, Pierre (1662). La logique ou l’art de penser, Editions de 1664, de 1683, Réédition Flammarion 1970 (d'après l'édition de 1683)
Couturat, Louis (1901). La logique de Leibniz, Alcan, Paris
Couturat, Louis (1903). Opuscules et fragments inédits, Alcan, Paris.
Descartes, René (1637). Discours de la méthode, Réédition 1966 par G. Rodis-Lewis, Garnier-Flammarion
Descartes, René (1628). Regulae ad directionem ingenii (1628), réédition de 1970, Règle pour la direction de l'esprit, Vrin
Euler, Léonard (1768). Lettre à une princesse d'Allemagne, 17 février 1768, Saisset, Paris 1843
Gergonne, Joseph-Diez (1817). "Essai de dialectique rationnelle", Annales de mathématiques pures et appliquées, tome 7, pp. 189-228
Lambert, Johann Heinrich (1764). Neues Organon, Wendler, Leipzig
Lambert, Johann Heinrich (1782). Logische und Philosophische Abhandlungen, Ed. Jean Bernoulli, Berlin
Leibniz, Gottfried W. (1765)., Nouveaux essais sur l'entendement humain, Réédité par Flammarion, Paris, 1970
Dupleix, Scipion (1607) La logique ou art de discourir et raisonner, réédition dans le Corpus des Oeuvres de Philosophie en Langue Française, Fayard, 1984
[1] Propositions hypothétiques ou conditionnelles :
Elles correspondent au schéma « Si A alors B », où A et B peuvent être elles-mêmes des propositions. Elles sont hors de la syllogistique classique.
[2] Propositions catégoriques :
Ce sont celles qui affirment ou nient quelque chose « Il est vrai que . . . » ou bien « il est faux que . . . ».
[3] La Formule de Newton donne l'expression de la puissance d'une somme en fonction des puissances successives des termes :
(a + b)n = an + n.an-1.b + . . . + n.a.bn-1 + bn, où n désigne un entier positif.
[4] La Formule de Taylor exprime la valeur d'une fonction en un point sous forme d'une série où interviennent les dérivées successives : f(x + a) = f(x) + f'(x)a + f''(x)a2/2! + . . . + f(n)(x)an/n! + . . etc. La valeur de la dérivée niéme en x, f(n)(x) est écrite par Leibniz avec ses notations propres, c'est à dire sous forme de quotient de différentielles dn(x)/dxn.
|
|